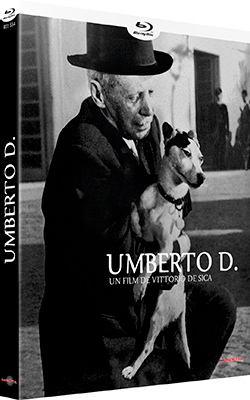Umberto D.
Publié par Stéphane Charrière - 9 septembre 2021
Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres
Édité en cette fin d’été 2021 en Blu-ray et DVD (copie superbe) par Carlotta Films, Umberto D. de Vittorio De Sica nous permet de revenir sur l’une des écoles cinématographiques les plus commentées de l’histoire du cinéma : le Néo-réalisme. Considéré comme l’un des films qui ont scellé la fin de ce courant artistique, Umberto D., réalisé en 1952, a de quoi surprendre le cinéphile contemporain par la qualité de sa dramaturgie et par la fausse simplicité de sa mise en scène.
Et la surprise ne s’arrête pas là. À n’en pas douter, cette édition d’Umberto D. permettra de découvrir un cinéaste, De Sica. Un auteur souvent oublié. Pour évoquer le Néo-réalisme, on lui préfère Rossellini ou De Santis par exemple. Pourtant De Sica est le cinéaste de cette période qui a le plus travaillé avec Cesare Zavattini, considéré comme le scénariste qui a le mieux traduit les intentions qui habitaient le Néo-réalisme. Car Zavattini est celui qui a poussé l’idée de traduire la réalité italienne de l’après-guerre jusqu’à en faire des films qui ont valeur de constats historiques. Aspiration partagée par De Sica puisque la collaboration artistique entre les deux hommes se développera autour de 26 projets cinématographiques. L’idée principale qui réunissait Zavattini et De Sica tenait en un principe : montrer les faits de manière à respecter leur dimension ontologique.

Dans Umberto D., De Sica construit d’ailleurs une séquence qui répond parfaitement à cette attente. Maria (Maria-Pia Casilio) la bonne de la pension dans laquelle vit Umberto se lève au petit matin. La caméra suit Maria sans jamais succomber à l’envie de surinterpréter ses gestes. L’espace de quelques minutes, le film prend pour personnage principal Maria. Zavattini et De Sica lui accordent un temps filmique très court qui brosse le portrait de cette jeune femme. Un temps qui se définit aussi par sa durée substantielle présentée ici sans artifice. Pas d’ellipse, pas de contraction temporelle, juste le réel et la durée de ce réel. La comédienne accomplit toute une série de gestes qui, finalement, nous racontent une histoire qui s’inscrit en parallèle de celles d’Umberto et de son chien Flike. Le film décrit le monde des humbles.
Mais cette séquence apporte son lot d’informations pour mieux appréhender ce qui se joue en dehors de l’espace qui lui est réservé, celui de la cuisine et des pièces de la pension. La jeune femme est une figure de l’aliénation des plus faibles par les plus riches. Politique. Le temps du film est en suspens : trois minutes consacrées à un autre versant de la déshumanisation initiée par le fascisme et insidieusement intégrée aux fonctionnements sociaux. Comme en écho à ce constat, la séquence du chenil apparaît également comme une parenthèse métonymique. Umberto rentre chez lui après un bref séjour à l’hôpital. La propriétaire des lieux a, entre-temps, manigancé pour que le chien échappe à la surveillance de Maria. Umberto se rend alors à la fourrière. Là, Umberto constate que le traitement réservé aux chiens errants, perdus ou abandonnés, traduit à sa manière un fonctionnement social qu’il n’est donc pas le seul à subir. S’ils ne sont pas récupérés rapidement par leurs propriétaires, les chiens sont éliminés. Les chiens sont gazés.

Le film se déroule en 1952 et le constat est terrible. Les leçons de l’histoire ne sont pas retenues, même les plus récentes. Rien ne s’est amélioré par rapport à l’immédiat après-guerre, au contraire. L’Italie ne se relève pas des années de fascisme (1922-1945). Et par rapport à 1945, pas ou plus d’unité sociale comme on pouvait en voir ou espérer en voir surgir une chez Rossellini. Tous les espoirs collectifs sont déçus.
Umberto D., le film, contribue, nous l’avons dit, à marquer la fin du Néo-réalisme. Car si le Néo-réalisme est une forme d’exaltation de ce qui animait une grande partie de la classe prolétarienne pour lutter contre l’ordre qui régissait la politique italienne, le cinéaste décrit un monde où l’individualisme, déjà, réduit à néant l’utopie d’une reconstruction étatique et sociale. La société, comme force, comme groupe, n’est plus.
La scène de la manifestation qui ouvre le film démontre d’ailleurs que les élans collectifs n’ont plus aucun impact sur la société qui reste sourde aux revendications des plus démunis qui défilent, en l’occurrence ici des retraités. Pire, la société est indifférente à la souffrance d’autrui. La scène se conclue par une série de plans où les manifestants, tous âgés et usés, sont expulsés d’une place romaine comme s’il s’agissait de canaliser les errances de quelque bétail récalcitrant à l’idée de rentrer à l’étable. Il y a la volonté d’éliminer de la société les retraités, de ne plus les voir, leur sort laisse de marbre. Car tout, dans l’image, indique qu’ils n’ont aucune importance aux yeux de ceux qui vaquent à leurs activités. Ils sont à la retraite, ils ne produisent plus rien, ils ne servent plus à rien. Allez ouste !

Du groupe, un être est isolé. D’abord par la mise en scène (plusieurs plans sur le personnage pendant la manifestation) puis par ses camarades de lutte qui lui font sentir qu’il vaut encore moins qu’eux. Il est tout en bas de l’échelle d’une société individualiste. Survivre est affaire de chacun et sauve qui peut. C’est Umberto D. (le D. est son deuxième prénom qui, après le nom de famille, disparaît lui aussi ; image de la déshumanisation en marche). Le constat est édifiant : les intérêts des uns ne concernent pas les autres.
Umberto D. est à rapprocher du contenu thématique et des réflexions sociales et politiques soulevées par De Sica dans Le voleur de bicyclette. Quelques éléments narratifs et thématiques reviennent. Parmi ceux-ci, la présence du cinéma, théâtre du rêve donc du mensonge. Antonio Ricci, pour sortir sa famille de la misère, trouve un emploi qui promet des jours meilleurs. Il colle des affiches, notamment de cinéma sur les murs de Rome. Alors qu’il s’acquitte de sa tâche on lui vole sa bicyclette, outil indispensable pour conserver son emploi et parcourir les points d’affichage répartis dans la capitale italienne. Ici, dans Umberto D., le cinéma et ses mirages sont encore présents mais de manière plus discrète. Un cinéma, le lieu, occupe le rez-de-chaussée de la pension où loge Umberto. Il semble toujours fermé, l’illusion ne fonctionne plus. Le cinéma est un espace déserté. Le théâtre ne vend plus rien, les mirages ont disparu. Nous sommes en 1952, quatre ans après Le voleur de bicyclette et les espoirs sont déjà réduits à néant.

De la même manière que le tunnel, dans Le voleur de bicyclette, figurait une issue inaccessible à la situation vécue par Antonio Ricci, le couloir de la pension et les lieux arpentés par Umberto sont sans perspective. Les actes et les volontés d’Umberto sont toujours circonscrits à une spatialité qui contraint le personnage à fréquenter toujours les mêmes lieux sans pouvoir s’en extraire. Nulle sortie. Il fut un fonctionnaire, un rouage, il fut l’instrument d’un système qui continue de l’emprisonner et de le condamner. Umberto n’est que le composant d’une mécanique sociétale qui dispose de son existence depuis toujours.
La scène publique italienne se réfugie derrière un théâtre d’apparat dans lequel on ne peut accepter l’image que renvoie Umberto de la réalité italienne. Umberto D. est le reflet d’une tragédie universelle qui, hélas, encore aujourd’hui agit sur nos comportements. Voir Umberto D., c’est revenir à l’origine de l’échec social de nos sociétés contemporaines. C’est aussi, pourquoi pas, la possibilité de voir à quel moment nous avons raté quelque chose afin d’envisager de comprendre qui nous sommes et d’éviter de reproduire indéfiniment les mêmes erreurs.

Crédit photographique : © Courtesy Rialto Pictures / ©Carlotta Films
Suppléments :
ENTRETIEN AVEC JEAN A. GILI (29 min – HD*)
SEULS AU MONDE (25 min – HD*) analyse de scènes de Jean-Baptiste Thoret
BANDE-ANNONCE ORIGINALE
* En HD sur l'édition Blu-ray™