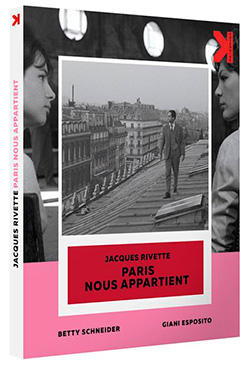Paris nous appartient
Publié par Stéphane Charrière - 24 février 2022
Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres
Idée réjouissante que celle de Potemkine Films d’éditer dans une copie remarquablement bien restaurée de Paris nous appartient, le premier long-métrage de Jacques Rivette. Le projet fut complexe à monter : emprunt financier aux Cahiers du cinéma, retard de financement, participation de Truffaut et Chabrol à la production dans un second temps, bref, le film débuté en 1958 fut projeté pour la première fois en salle en 1961. Paris nous appartient est un petit précis d’intentions filmiques propres aux idées avancées par la Nouvelle Vague. De plus, le film correspond à ce qui dictait les goûts rédactionnels et les avis critiques formulés dans les colonnes des Cahiers du Cinéma par les figures marquantes de la revue. L’ouverture du film est une sorte de point de convergence entre la pratique de la critique cinématographique, telle qu’exercée par Rivette au sein des Cahiers, et les intentions qui se dissimulaient derrière les articles. Paris nous appartient s’ouvre sur deux séquences explicites. La première correspond à un plan-séquence qui laisse au générique le soin de livrer les informations quant à la production du film et la seconde est initiée par un pano-travelling qui prolonge la contextualisation formelle et narrative introduite par le premier plan du film.
En à peine moins de 3 minutes d’images, l’essentiel est dit : il est avancé que la matière même du film sera sa mise en forme (omniprésence de la machinerie) et que la technique utilisée sera au service de la mise en scène. Nulle ambiguïté dans le plan-séquence d’ouverture. Un travelling depuis un train invite le spectateur à entrer dans un monde qui se définit à partir de sa nature ontologique : la réalité française de la fin des années 1950. Montrer le monde tel qu’il est et respecter les contraintes esthétiques que ce monde impose à la mise en scène. La Nouvelle Vague est là, déjà. Un travelling donc, un déplacement physique qui incite le spectateur à voir par la fenêtre d’un train une suite de paysages qui nous rapprochent de Paris. Le train a depuis toujours, au moins depuis la projection en janvier 1896 à Lyon de L’entrée en gare d’un train à La Ciotat, fait bon ménage avec le cinéma. Ne serait-ce que pour les familiarités qui existent entre la constitution d’un train et la singularité de ce procédé appelé travelling qui a su, entre autres, faire du cinéma un art au début des années 1910. Le carrello (travelling) fut mis au point par Giovanni Pastrone (dépositaire du brevet) afin de permettre aux spectateurs de Cabiria (1914) de visiter le décor, de conquérir l’espace et de s’approcher des comédiens. L’objet, d’une certaine manière, de cette scène d’ouverture. Par ailleurs, le travelling rejoint la nature physique du train. Un travelling se compose d’une plateforme montée sur roues et posée sur des rails. Au début de Paris nous appartient, il est donc question de cinéma.

Il nous faut alors accepter comme procédé actif et seul maître du schéma narratif qui va suivre, le cinéma. L’ouverture de Paris nous appartient ressemble à l’exposition d’une profession de foi. Alors il faut croire les images, se laisser guider par elles et se défier du texte. Ce que nous rappelle la citation de Charles Péguy qui clôt le plan séquence inaugural qui termine sa course, comme le train, en gare d’Austerlitz à Paris. La phrase de Péguy introduit une contradiction puisqu’elle affirme le contraire du titre du film. Rivette nous dit que Paris nous appartient tandis que Péguy affirme que Paris n’appartiendra jamais à personne. Qui croire ? Peu importe. C’est ce qui se dégage de la contradiction qui fait sens ici et qui, d’une certaine manière, pose les enjeux du film. Le cinéma au centre de tout, nous l’avons dit, le cinéma comme une illusion plus belle que la réalité qui féconde cette illusion et qui devient, au moins le temps d’un film, Paris nous appartient, la seule vérité qui nous importe.
Le travelling nous entraîne dans Paris. Nous y arrivons. Nous y sommes. Montrer la ville telle qu’elle est, telle qu’elle se pratique au quotidien par ses habitants. Ce qui n’exclue pas la possibilité d’y voir naître des phénomènes fictifs, des situations ludiques qui prêtent à réflexion ou autre. Le trajet qui nous conduit de la gare d’Austerlitz à un appartement parisien est éludé. Après le fondu au noir qui clôt le générique et le plan-séquence depuis le train, un panoramique effectue un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d’une montre sur des toits d’immeubles. Puis nous prenons conscience que le panoramique est un pano-travelling puisque la caméra combine les deux mouvements simultanément. La caméra recule et nous entrons par une fenêtre dans un petit appartement. Une voix féminine d’abord hors champ lit un texte en anglais. Une jeune femme se présente alors à nous, concentrée, et poursuit la lecture à voix haute jusqu’à ce que des pleurs venus de l’appartement voisin, trop présents, interrompent le fil de la pensée de la jeune femme.
Mais revenons sur le mouvement de caméra qui introduit cette nouvelle séquence. Le panoramique qui définit un arc de cercle sur le toit d’immeubles parisiens. Pendant son exécution, une date nous est donnée, juin 1957. Avant que le mouvement ne s’arrête, la caméra recule, nous laisse voir le cadre d’une fenêtre (celle qui nous permettait de voir à l’extérieur) et entre dans un appartement. La fenêtre, espace déambulatoire mental, interface qui fait cohabiter l’ailleurs dans l’ici, invitation à imaginer un espace d’une nature différente de celui dans lequel nous nous trouvons.

L’entrée dans la fiction évoque Hitchcock, cinéaste adulé par les critiques des Cahiers. Dans Fenêtre sur cour (1954), le générique d’ouverture défile pendant que trois rideaux d’une fenêtre se lèvent l’un après l’autre pour laisser voir, depuis un intérieur new-yorkais, ce qui sera le théâtre de l’œuvre à suivre. Lorsque les rideaux sont totalement relevés, apparaît le nom d’Hitchcock, tout est en place, le drame peut commencer. La caméra effectue alors un travelling avant. Fini le théâtre, place au cinéma. Une fois le seuil de la fenêtre franchi, nous sommes dans le décor du film, la caméra stoppe sa course en avant. Cut. Un panoramique amorce alors un mouvement circulaire qui présente le décor, la cour qui sépare plusieurs bâtiments. La caméra poursuit le mouvement, elle remonte le long d’une façade puis embrasse quelques fenêtres des immeubles qui donnent sur la cour. Avant que le panoramique ne se termine, la caméra amorce un travelling arrière (pano-travelling donc), traverse une fenêtre, panote encore et se fige en très gros plan sur le crâne de James Stewart assoupi.
L’effet est bien le même dans Paris nous appartient, le très gros plan en moins. Et il livre quelques hypothèses de lectures que le spectateur a le choix de suivre ou non. Un jeu de pistes, un jeu de hasard, un jeu de l’oie qui sera au cœur du travail ultérieur de Rivette. Le très gros plan sur le crâne de James Stewart était explicite : l’univers visité par la caméra au début du plan est en lien direct avec ce qui se déroule dans les pensées de l’homme endormi : un rêve ? Une réflexion ? Un dilemme ? Un fantasme ? La suite nous le dira. Idem ici. Le texte lu par la jeune femme, Anne (Betty Schneider), convoque un monde parallèle à la réalité parisienne. Des questions : une étrangère ? Une étudiante ? La lecture à voix haute agit comme une voix off, il est question d’accéder au fonctionnement de la pensée de la jeune femme. La mise en relation de l’intimité avec l’espace collectif amorcée par le mouvement de caméra se prolonge avec la dimension introspective de la situation. Des énigmes, déjà. Et puis l’extérieur (les pleurs de la voisine) s’invite à nouveau dans l’intimité de la jeune femme au point d’interrompre son activité. Le discours de la voisine est incohérent : il est d’abord question de la mort d’un homme, de la fin du monde, d’un possible complot avant qu’elle ne retrouve une attitude plus « normale » et qu’elle ne demande à la jeune femme de rejoindre son appartement voisin. L’attitude est sujette à interprétation mais intègre au récit initial une dimension mystérieuse. Introspection, solitude, mystères, Paris nous appartient est déjà fourni en éléments qui le rapprochent du film policier américain et plus particulièrement de ce que l’on nomme communément, le film noir. Le film noir et ses inquiétudes, ses introspections. Le film noir comme espace filmique qui a su mettre en évidence les angoisses existentielles de l’Américain moyen pendant et après la Seconde Guerre Mondiale. Modèle transposable en France ? Pourquoi pas.

C’est en tout cas sur ce principe narratif que se construit Paris nous appartient. Un autre élément qui codifie ce type de films dits noirs et commun à Paris nous appartient, une paranoïa diffuse qui s’invite à tous les niveaux de fabrication du film. Ne serait-ce que parce que l’incertitude et l’incompréhension qui s’emparent d’Anne nourrissent tous les fantasmes. Les situations inexplicables et inexpliquées que nous prenons en cours, les phrases incomplètes, les disparitions d’individus ou les comportements étranges des personnages qui entrent soudainement dans la vie d’Anne participent de ce sentiment qui envahit l’espace filmique. Le doute. Jusqu’au bout, cette sensation désagréable est distillée par la mise en scène. Jusque dans la citation explicite de Metropolis de Lang. Une réunion entre amis, une soirée. On projette un film. Accès privé à un écran sur lequel se projette les idées qui nourrissent le quotidien des personnages. Le film qu’ils regardent et qui, en même temps, nous parle d’eux, de ce qu’ils vivent et de leur perception du monde, c’est Metropolis. Plus précisément, la scène de Babel. Un monde qui s’effondre. Effondrement qu’il faut entendre de plusieurs manières. Il est question de la fin de certaines utopies, de sociétés aux modèles dépassés et bien sûr, à titre personnel, le monde d’Anne. Et puis c’est aussi la fin d’un cinéma, pense Rivette.

Paris nous appartient s’offre aux spectateurs comme une promesse. Celle de regarder un monde nouveau. Celle d’une nouvelle considération de l’art cinématographique. Paris nous appartient affirme qu’il nous faudra compter avec une approche formaliste du cinéma qui, dans la modernité qu’elle convoque, supplante le récit traditionnel calqué sur un modèle littéraire ou théâtral. Pour Rivette, il ne s’agit pas ici de reproduire le monde mais d’en donner une vision qui passe par l’exploration d’une réalité tamisée par la modernité d’un art autonome, le cinéma. Cette croyance immodérée dans le pouvoir évocateur de l’image filmique est à estimer selon la volonté et l’empreinte inaltérable de la Nouvelle Vague. Paris nous appartient est la tentative de s’inscrire, avec le cinéma, dans la marche d’un monde en mutation. Ce qui, dès un premier film, gagne l’admiration du spectateur.

Crédit photographique : Copyright AJYM FILM / Potemkine Films
Suppléments :
Analyse du film par Pacôme Thiellement (50')
Entretien avec Betty Schneider (2021, 10')
Interview de Jacques Rivette, "Cinéastes de notre temps", "La Nouvelle Vague par elle-même" (1964, 6')
Court métrage : "Le Coup du berger" de Jacques Rivette (1956, 29')