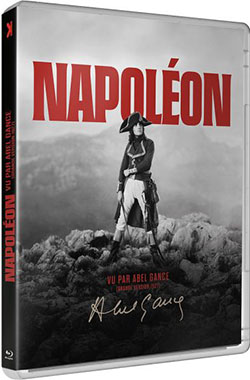Napoléon vu par Abel Gance
Publié par Stéphane Charrière - 24 novembre 2025
Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres
L’édition est monumentale, à l’image du film auquel elle rend hommage. Napoléon vu par Abel Gance est un film hors norme : son élaboration, son tournage, sa technique, sa durée, la multiplicité de ses versions et l’ampleur de sa dernière restauration contribuent ensemble à en faire une œuvre mythique. Résumons l’historique du film établi par George Mourier, chercheur, réalisateur, monteur et scénariste chargé par la Cinémathèque française de diriger en 2008 la restauration du film dans sa version dite « grande ».

Pour comprendre l’ambition initiale du projet, il faut revenir à l’admiration que Gance voue à Griffith. Motivé par Charles Pathé, Gance se rend aux États-Unis afin de trouver matière à penser sur l’art cinématographique. Gance rencontre Griffith et le cinéaste français assiste même à quelques moments du tournage des Deux orphelines. Il observe et engrange des informations. Il y a dans le voyage de Gance une motivation certaine : repositionner le cinéma français, exsangue au sortir de le Première Guerre mondiale, au centre de l’échiquier où se situe désormais le cinéma américain. Au contact de Griffith, une idée germe dans l’esprit de Gance. Ce dernier conçoit un projet d’une ampleur inédite : une fresque napoléonienne en six volets dont l’ambition exige immédiatement des financements internationaux. La chance lui sourit. Il est contacté par deux financiers (Wengeroff et Stinnes) qui, intéressés par la création d’un syndicat européen du film, engagent leur société (Westti-Film GM) et s’associent en participation avec Gance en 1924 pour la réalisation de six films. L’argent appelle l’argent et des financiers européens se greffent sur le projet. Gance s’installe à Fontainebleau et rédige un scénario conséquent reposant sur une documentation historique toute aussi imposante. Gance ne néglige cependant pas la matière littéraire existante, notamment pour la dimension épique qu’il souhaite atteindre (Dumas, Hugo…). Le tournage, entamé en janvier 1925 aux studios de Billancourt, se poursuit jusqu’en juin, entre Paris, Briançon et la Corse (Ajaccio et ses environs). Gance rentre à Paris mais le tournage est alors interrompu en raison de la faillite de la Westi-Film GM. Gance doit rechercher de nouveaux financements.

Il parvient à ses fins à l’automne 1925 avec l’aide de Charles Pathé et le soutient de Raymond Bernard qui retarde le lancement de son projet afin qu’Abel Gance obtienne les fonds nécessaires à la poursuite de son œuvre. En janvier 1926, le tournage reprend. Faisant fi de nouvelle péripéties (accident de Gance lors du tournage de la prise de Toulon), les prises se succèdent jusqu’à l’été 1926. Commence dans la foulée le montage. Long, complexe (les surimpressions, multiples caméras, le triple écran…).
Finalement, le 7 avril 1927, à l’opéra Garnier à Paris, sera projetée la version dite « Opéra », la version la plus courte (5200 mètres de pellicule pour 3h 47 minutes de projection). Puis tout se complique. Les 8 et 9 mai et les 11 et 12 mai 1927 apparaît la version dite « Apollo », projetée au cinéma Apollo pour la presse et les distributeurs. La version affiche d’abord une durée de 9h40 minutes et sera réduite à 9h27 minutes.

À l’automne 1927, une version dite, à tort, « définitive » est envoyée à la MGM. Ses 7 h 08 seront pourtant réduites à 1 h 46 dans l’exploitation américaine de 1929. L’histoire des versions ne s’interrompt pas pour autant. En 1934, Abel Gance décide de se réapproprier son film et le sonorise. Il tourne de nouvelles scènes, parfois avec les acteurs de 1927, parfois avec de nouvelles figures qui se substituent au casting initial. Gance postsynchronise, modifie le montage. Le film dure 2h20 minutes. Mais ce n’est pas tout. En 1968, Abel Gance revient sur son Napoléon. Une nouvelle postsynchronisation, de nouveaux plans tournés, un montage revu… Bonaparte et la Révolution sortira en 1971 pour une durée de 4h35 minutes.

L’histoire matérielle du film est tout aussi complexe, comme en témoignent les restaurations successives de Marie Epstein et Henri Langlois à la Cinémathèque en 1953 à partir de la version de 1927, jusqu’au travail de Brownlow, Ballard puis Mourier. Kevin Brownlow, historien essentiel du film, a produit trois restaurations : une première (4 h 50), une seconde (5 h 13), réalisées entre 1969 et 1983, puis une troisième (5 h 30) présentée en 2000. Bambi Ballard, en 1992 pour la Cinémathèque française, produira un travail à partir de la restauration de Brownlow en 1983 en y incorporant de nouveaux éléments trouvés. Enfin, en 2024, nous arrivons au remarquable travail de Georges Mourier et de ses collaborateurs au premier rang desquels il est nécessaire de souligner l’apport essentiel de Laure Marchaut.
Monumental. Au-delà des chiffres, un film existe. Aussi se soumet-il à l’examen et il convient de le traiter ainsi, ne serait-ce que par respect pour son auteur initial et par respect pour tous ceux qui se sont appliqués à produire la meilleure (ou la plus complète) version possible de ce Napoléon. Dans cette grande version, celle qui suit le séquencier Epstein et qui se rapproche le plus, donc, de ce que Gance avait imaginé après les projections au cinéma Apollo, le spectateur est frappé par un traitement de l’épique inspiré par Griffith.

Abel Gance, s’il a bien l’intention de réaliser un film porté par un souffle épique, n’en délaisse pas pour autant les inspirations individuelles lovées au sein de l’élan collectif. Dans la démesure technique et formelle, cadrages et montage éclairent le récit napoléonien d’une dimension chargée de vertus identifiables et reconnaissables à l’échelle d’une civilisation. Le film impressionne encore aujourd’hui. D’abord pour ses inventions techniques. Gance se refuse aux limites imposées par le cadre, aussi a-t-il l’idée de ce qu’il nomme la polyvision, un système de prise de vue à trois caméras mis au point par André Debrie à l’été 1925. Rendre compte du grandiose et de la vision d’un homme qui s’est voulu et imaginé porteur d’une destinée nationale, voire plus. Le principe paraît simple dans son énoncé mais sa mise en œuvre se révèle beaucoup plus complexe. Il s’agissait de positionner sur un support vertical trois caméras Parvo K montées sur trois plateaux indépendants. Un moteur électrique commande les trois caméras simultanément ou indépendamment. Les trois appareils pouvaient être orientés selon un axe variable. La caméra qui produisait l’image centrale pivotait sur 10 degrés de chaque côté tandis que les caméras qui fournissaient les images latérales pouvaient être orientées vers le centre de 10 degrés et de 90 degrés de chaque côté.

Gance, inspiré par le triptyque pictural (œuvre composée de trois parties complémentaires) reprend au pied de la lettre la fonctionnalité discursive du procédé illustratif. Non seulement il considère la polyvision comme un accroissement possible de l’image centrale (phénomène additif qui voit les trois cadres s’ajouter pour former une image ultra large) mais, en plus, en fin connaisseur de l’histoire des arts, il imagine aussi le dispositif comme une confrontation simultanée des images (les images latérales construisent un principe dialectique qui contraint le spectateur à associer ou à dissocier des idées). Nous sommes en présence ici d’une démarche qui évoque l’attitude des cinéastes soviétiques, Eisenstein ou Vertov en premier lieu. Dans l’intentionnalité, il y a la volonté de soumettre le spectateur à une série d’épreuves visuelles qui visent à le faire changer d’état pour prendre la mesure de l’homme qu’était Napoléon et d’en faire un symbole multiple (nation qui s’éveille et se soude, accomplissement de la Révolution, avènement d’une classe sociale, etc.).
La logique qui anime Gance ici se manifeste sous deux autres formes, à commencer par des surimpressions (illustration d’une pensée en action) et par l’usage du splitscreen (écran partagé) dans deux séquences qui rejoignent trait pour trait les effets de la polyvision : la bataille d’oreillers dans le dortoir de l’école de Brienne et le siège de Toulon. Notons quelques différences cependant. La division de l’écran répond aux mêmes intentions que la polyvision. Lors du passage de l’école de Brienne, l’écran est d’abord scindé en quatre images puis en neuf pour rendre compte sous différents angles de l’intensité de la bataille, ce qui reprend à son compte le phénomène adjuvant prêté à la polyvision. Lors de siège de Toulon, c’est l’autre aspect de la polyvision qui est ici reproduit : mesurer les liens de causalité entre l’attitude de Napoléon et celle des soldats sur le champ de bataille (dialectique). Pour ce qui est de la surimpression, Gance joue avec la mémoire visuelle du spectateur. Gance confère à la surimpression, principalement utilisée pour rendre compte de la rapidité à laquelle Napoléon pense, réfléchit, synthétise, comprend et décide, une autre fonctionnalité, celle qui lui permet d’éviter des redondances visuelles ou textuelles. Les surimpressions sollicitent directement la mémoire du spectateur : les images superposées, jusqu’à seize strates, renvoient en majorité à des plans déjà vus, réactivant ainsi le souvenir visuel. À ce titre, Gance comparait cet usage précis de la surimpression à la présence d’instruments dans un orchestre que l’oreille ne saisit pas forcément mais qui sont bel et bien présents dans la pièce musicale.
L’intitulé Napoléon vu par Abel Gance rappelle que l’œuvre repose sur l’affirmation d’une subjectivité. En plaçant son nom en fin de projection, Gance ne se contente pas de signer son film : il inscrit son geste dans une tradition propre aux arts visuels où l’artiste revendique la paternité et la responsabilité de la représentation. Loin d’une neutralité historiographique, le cinéaste propose une interprétation fondée sur une lecture personnelle du personnage nourrie par la littérature, par les arts plastiques et par une conception du cinéma comme instrument de monumentalisation.

Une telle démarche explique la démesure d’un film qui excède les normes de sa période de réalisation. Par son ampleur narrative, par l’extension de son dispositif technique, par la multiplication de ses versions, Napoléon constitue un objet unique, dont l’histoire matérielle est aussi complexe que la trajectoire de son protagoniste. Les restaurations successives ont cherché, au-delà de la simple reconstruction, à rendre perceptible ce que Gance avait projeté : une œuvre mouvante, susceptible de se déployer selon plusieurs amplitudes temporelles et visuelles. Cette plasticité historique et formelle confère au film une dimension résolument romantique où la figure de Bonaparte devient l’allégorie d’un art en quête d’absolu. En filmant Napoléon, Gance filme donc aussi sa propre conception du cinéma : un art total, incandescent, plus grand que le réel. Près d’un siècle plus tard, le film conserve une force intacte, non parce qu’il serait complet mais parce qu’il donne à voir ce qu’aucune version ne pourra épuiser : l’utopie d’un cinéaste qui voulut créer, dans un même geste, une épopée nationale, un manifeste esthétique et un rêve de cinéma absolu.

L'édition collector, nous l'avons dit, est exceptionnelle. Au-delà d'une image restaurée avec soin, figurent dans le coffret des entretiens, des analyses, un documentaire sur l'histoire du film, des documents filmés sur le tournage du film, le film de Nelly Kaplan consacré au Napoléon, un livre somptueux... Que dire ? Il y a chez Potemkine la volonté de produire un coffret qui regroupe tout ce qu'il est possible de fournir comme documents aptes à éclairer sur la grandeur du film de Gance. Une dimension pédagogique n'est pas absente non plus. L'ensemble décuple le plaisir de la découverte et permet de saisir l'importance historique et cinématographique de l’œuvre. C'est beaucoup. Coffret à considérer comme une somme. Il en devient indispensable.

Crédit photographique : © La Cinémathèque française / Pathé
Suppléments :
"Autour de Napoléon" : Documentaire de Jean Arroy sur la prise de vue du film (1926, version restaurée, 59')
"Abel Gance et son Napoléon" : Documentaire de Nelly Kaplan (1984, version restaurée, 61')
"La Saga du Napoléon d'Abel Gance" : Film réalisé et produit par Georges Mourier, directeur de la reconstruction et de la restauration du film (2025, 55')
"Napoléon à contre-jour" : Analyse par Élodie Tamayo, historienne du cinéma (2025, 17')
"L'Histoire vue par Abel Gance" : Entretien avec Élodie Tamayo (2025, 33')
"Napoléon au cinéma" : Entretien avec David Chanteranne, historien (2025, 30')